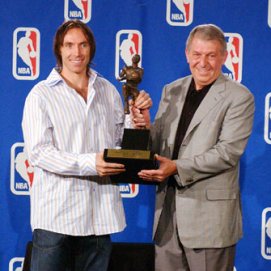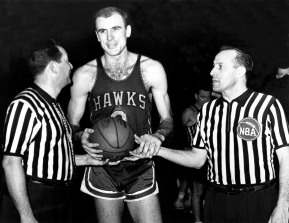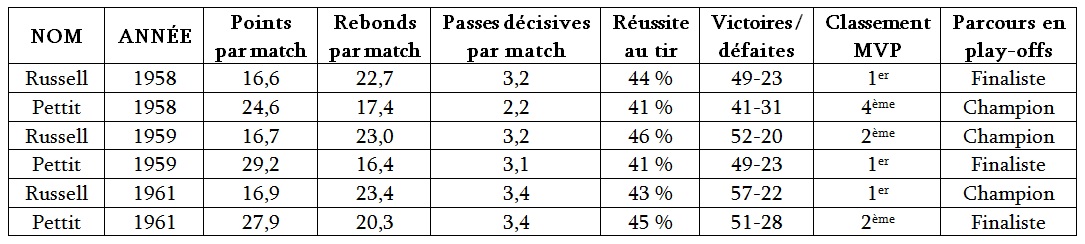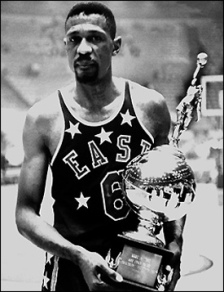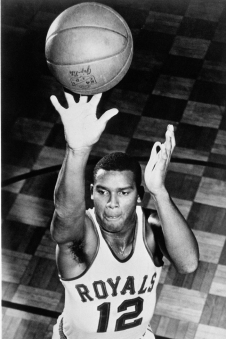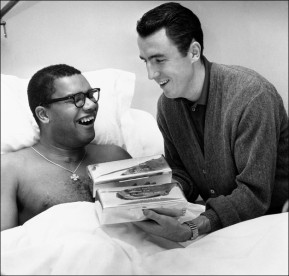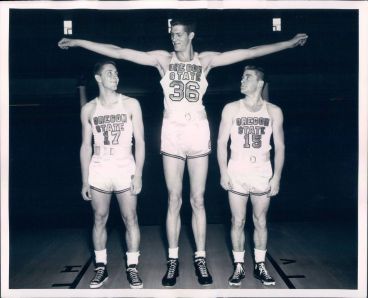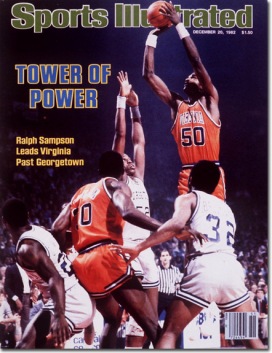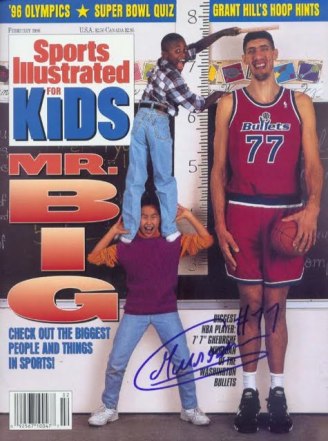*****
« Malice at the Palace ». C’est le nom donné à l’événement survenu en NBA le 19 novembre 2004, le plus incroyable du nouveau siècle et le plus traumatisant du mandat de David Stern en tant que commissionnaire. La vidéo de l’incident a été vue, revue, et retirée de YouTube pour violation des droits d’auteur plus que tout autre clip relatif à son sport. Bill Walton, alors commentateur pour ESPN, le qualifiera du « pire moment jamais vécu en trente ans de NBA ». Ce qui s’est passé cette nuit-là est allé bien au-delà des millions de dollars d’amendes et des nombreux matchs de suspension infligés par la ligue. Voici l’histoire en détail.
*****
1er juin 2004. Les Detroit Pistons éliminent de la course au titre les Indiana Pacers après une Finale de Conférence Est électrique. Les Pistons ont enlevé un sixième match décisif, profitant notamment des performances décevantes de Jermaine O’Neal et Jamaal Tinsley, deux des joueurs-clef d’Indiana. Quinze jours plus tard, Detroit bat les Lakers en finale pour remporter, à la surprise générale, le titre de champion NBA. Les Pacers ont ruminé leur défaite tout l’été ; sur le papier, leur équipe était meilleure que celle des Pistons, et ils avaient le sentiment d’avoir laissé passer leur chance. Bien qu’ayant des styles de jeu similaires, les deux équipes ne s’aimaient pas ; c’était une rivalité à l’ancienne, comme celle entre les Knicks et les Bulls. Le triomphe des Pistons a donc laissé les Pacers particulièrement amers.
Durant l’intersaison, Indiana renforce ses troupes en recrutant Stephen Jackson, un excellent petit ailier au jeu très intense. Avec Reggie Miller (futur Hall of Famer), l’intérieur Jermaine O’Neal (All-Star) et le défenseur de l’année Ron Artest, les Pacers se positionnent parmi les favoris dans la quête du titre. Les Pistons, quant à eux, conservent sans surprise les joueurs qui leur avaient permis de remporter le titre (le colosse Ben Wallace, son homonyme Rasheed, l’arrière Rip Hamilton, le meneur Chauncey Billups, et le longiligne ailier Tayshaun Prince) et renouvellent simplement leur banc : Corliss Williamson, Mehmet Okur et Mike James s’envolent vers d’autres horizons, pendant que Antonio McDyess, Carlos Delfino et Derrick Coleman rejoignent l’effectif.
Deux semaines à peine après le début de la nouvelle saison, les Pacers retrouvèrent les Pistons pour la première fois depuis leur défaite en play-offs, et dominèrent la rencontre. Les Pistons revinrent à moins de cinq points au quatrième quart-temps, avant de rater leurs dix tirs suivants. Indiana en profita pour creuser l’écart, grâce notamment à deux tirs à trois points d’Austin Croshere et de Stephen Jackson. Mais le match était devenu de plus en plus agité. Au cours du quart-temps, Rip Hamilton avait donné un violent coup de coude dans le dos de Jamaal Tinsley, qui aurait pu facilement valoir une faute flagrante. Finalement, à cinquante-sept secondes de la fin, Stephen Jackson réussit deux lancers francs pour donner à Indiana une avance insurmontable : 97 à 82.
À cet instant, le match était plié, mais la tension était toujours présente. On pouvait sentir des deux côtés une certaine animosité. Un membre de l’équipe des Pacers – dont l’histoire n’a pas retenu le nom – souffla à Ron Artest : « C’est bon, tu peux t’en faire un », ce qui signifiait qu’il pouvait régler ses comptes avec un joueur adverse. Artest décida de « se faire » l’intérieur Ben Wallace, qui l’avait balancé un peu plus tôt dans la structure du panier en bloquant son double-pas. Sur l’action suivante, il commit une grosse faute sur Wallace, en train de partir vers le cercle. En réaction, Wallace repoussa violemment Artest, le faisant reculer jusqu’à la table de presse.

*****
La colère de Wallace était compréhensible. Le match était terminé, et la faute inutile et d’une violence inhabituelle, ce qui explique sans doute pourquoi le joueur des Pistons a réagi comme il l’a fait. Mais Wallace traversait aussi une épreuve difficile : son frère Sam était décédé la semaine précédente et il revenait tout juste sur les parquets après avoir manqué deux matchs. Pendant que les arbitres et plusieurs joueurs des deux équipes cherchaient à éloigner un Wallace hors de lui, Artest décida inexplicablement de s’allonger sur la table de marque, les mains croisées derrière la tête, en attendant que tout se calme.
D’une certaine manière, Artest a fait preuve de provocation en se couchant sur cette table. Il a attrapé le casque radio d’un commentateur comme s’il allait s’adresser aux téléspectateurs, et paraissait plein d’arrogance. Il est resté allongé sur la table pendant une bonne minute et demie, sous les cris et les obscénités des supporters de Detroit. Les autres joueurs présents sur le terrain au moment de l’incident (O’Neal, Jackson, Tinsley et Fred Jones pour Indiana ; Rasheed Wallace, Hamilton, Hunter et Smush Parker pour Detroit), les entraîneurs et les arbitres étaient au milieu du terrain, en train de calmer Wallace. Personne ne se soucia donc de faire descendre Artest de la table. Fatigué, Wallace jeta finalement son brassard en direction de son adversaire, sans que celui-ci réagisse.
C’est à ce moment-là que tout dégénéra.
En s’allongeant sur la table de marque, Artest avait éliminé les barrières entre les joueurs et la foule – en principe, le banc et les responsables de presse font séparation. Artest était toujours en position couchée lorsqu’un spectateur jeta sur lui un gobelet en plastique rempli de bière et de glaçons. Artest, qui avait un tempérament explosif, n’était pas du genre à prendre quelque chose au visage sans riposter : il s’est immédiatement levé, et a sauté par-dessus les journalistes pour charger dans les tribunes.
La suite est assez difficile à décrire car il se passa plusieurs choses en même temps. En cherchant à rejoindre les tribunes, Artest piétina Mark Boyle, le commentateur radio des Pacers, lui infligeant des micro-fractures à cinq vertèbres. Mike Brown, l’entraîneur assistant d’Indiana, tenta d’arrêter son joueur, rata son coup, et continua à le poursuivre jusque dans les gradins. Artest attrapa celui qu’il croyait être le lanceur et le secoua violemment, sans s’apercevoir que le vrai coupable était son voisin. (Contrairement à la rumeur, il n’a frappé personne ; il a juste attrapé l’individu par le col.) Les autres spectateurs, voulant défendre l’agressé, s’en prirent aussitôt à lui.
Le spectateur qui avait réellement jeté le gobelet (un certain John Green) tenta d’attraper Artest par le cou. Au même moment, un autre spectateur jeta une bière sur Artest à bout portant, aspergeant au passage Stephen Jackson, venu prêter main-forte à son équipier. Jackson, aussi soupe-au-lait qu’Artest, riposta avec un grand coup de poing. Fred Jones, qui avait rejoint les deux joueurs, évita de peu une énorme droite lancée par David Wallace, un autre frère de Ben. Et Mike Brown, qui essayait de faire sortir Artest des tribunes, se fit lâchement frapper par derrière par Green. Les joueurs et les entraîneurs des deux équipes se précipitèrent alors à leur tour pour tenter d’arrêter les dégâts.

*****
La réaction d’Artest, aussi excessive soit-elle, était prévisible. Si vous faites défiler la liste des trente équipes ayant joué la saison 2005, et que vous vous demandez quels sont les deux équipiers les plus à même de déclencher une bagarre dans les tribunes, les grands favoris sont Artest et Jackson, deux joueurs qui pouvaient disjoncter subitement sans étonner personne. Quand on sait que les supporters des Pistons ont été hostiles toute la soirée, aucune personne suivant régulièrement la NBA n’a été surprise de voir Ron Artest et Stephen Jackson en train de se battre avec les spectateurs au troisième rang du Palace. (Jackson a d’ailleurs largement surpassé son équipier, envoyant des rafales de coup de poing dans les gradins comme s’il était en pleine crise de nerfs.)
À cet instant, le match se transforma en un véritable chaos. Jermaine O’Neal, qui voulait suivre le mouvement, en fut empêché par son garde du corps personnel. Jamaal Tinsley envoya valser un journaliste du Detroit News, qui lui barrait l’accès aux tribunes, et rejoignit la mêlée. Elden Campbell quitta le banc et, avec Rasheed Wallace, monta à son tour dans les gradins pour essayer de calmer les choses. Rick Mahorn, l’ancien « Bad Boy » devenu commentateur radio, tenta de séparer tout le monde, en s’efforçant de protéger les marqueurs officiels qui se trouvaient à ses côtés. Derrick Coleman prit sous son aile les ramasseurs de balle, dont le jeune fils de Larry Brown, l’entraîneur des Pistons. Les autres joueurs des Pistons – Darvin Ham, Antonio McDyess et Tayshaun Prince – restèrent sur le parquet, incrédules, à regarder le spectacle.
La question que l’on peut se poser à ce moment là est : mais que faisait la sécurité ? Il n’y en avait aucune. Le Place d’Auburn Hills était l’une des plus grandes arènes de la NBA et pouvait accueillir 22 000 personnes. Les agents de sécurité auraient dû grouiller dans le bâtiment, mais il n’y avait que trois policiers, tous dépassant la cinquantaine, pour gérer les choses. Aucun d’entre eux n’a pu empêcher les gens de sauter les uns par-dessus les autres et se joindre à la bagarre. Calmer les joueurs était tout aussi impossible ; lorsqu’un garde prénommé Mel tenta d’attraper O’Neal par la taille, celui-ci le balança au loin comme une poupée de chiffon. Un spectacle incroyable.
*****

Artest est resté dans les tribunes pendant quarante secondes, avant de se faire tirer vers le banc d’Indiana. De bonnes âmes tentaient de séparer les fans et les joueurs, mais la situation ne se calmait pas. Au contraire, elle semblait devenir de plus en plus périlleuse. La sécurité en sous-effectif était tellement préoccupée par ce qui se passait dans les tribunes que plusieurs personnes en profitèrent pour descendre sur le parquet et défier les joueurs. Alvin Shackleford et Charlie Haddad, deux supporters des Pistons, approchèrent d’Artest, dont le maillot était déchiré, et une nouvelle altercation s’ensuivit. Artest frappa Shackleford, et Jermaine O’Neal, arrivé en renfort, mit Haddad K.O. d’un énorme coup de poing. Il le frappa avec une telle violence que s’il n’avait pas glissé sur du liquide répandu au sol avant de le frapper, il l’aurait peut-être tué.
La vue des spectateurs frappés par Jackson et O’Neal a rendu les fans des Pistons encore plus furieux. Ils ont hué de plus belle et se sont mis à lancer sur le terrain tout ce qui leur tombait sous la main. Un supporter des Pistons a même jeté dans les tribunes une chaise en métal, occasionnant des blessures à plusieurs spectateurs. À cet instant, la police, introuvable pendant les dix premières minutes, entra enfin en action avec des sprays au poivre. Reggie Miller, qui ne jouait pas et avait suivi le match depuis le banc des Pacers en tenue de ville, supplia les policiers de ne pas l’asperger : « S’il vous plaît, non ! Je porte un costume à cent dollars ! » Le consultant NBA William Wesley quitta son siège, éloigna Artest de Haddad et Shackleford, et empêcha la police de le gazer, parvenant à le ramener de l’autre côté du terrain.
Tout le monde avait compris que les joueurs et les entraîneurs d’Indiana devaient rentrer au vestiaire le plus vite possible. Malheureusement, cela signifiait les escorter à travers le tunnel… au milieu des fans furieux. Larry Brown, l’entraîneur des Pistons, attrapa un micro pour demander aux supporters de se calmer, mais ce qui se déroulait sous ses yeux était tellement confus qu’il ne put prononcer un mot. Chaque fois que la situation paraissait sous contrôle, un nouveau combat éclatait. La violence était à son comble. Il y avait des blessés et des enfants en pleurs, dont le plus jeune fils de Darvin Ham, que les caméras de télévision montrèrent en train de sangloter, consolé par son frère. À cet instant, personne n’aurait été étonné de voir quelqu’un sortir un couteau ou un revolver. C’est dire à quel point la situation était inquiétante.
*****

Artest fut raccompagné vers les vestiaires sous une pluie de déchets et de projectiles. Stephen Jackson le suivit, en hurlant et en agitant les bras avec un air de défi pendant que les gens lui jetaient de la bière. O’Neal lui emboîta le pas, s’arrêtant pour insulter un fan qui avait jeté un objet, avant de se faire éloigner par Wesley et d’autres. Jamaal Tinsley, qui avait quitté le terrain, revint en brandissant un balai au-dessus de sa tête, mais fut renvoyé dans les vestiaires avant qu’il ne puisse en découdre. Finalement, de manière inattendue, les joueurs et les entraîneurs des Pacers sortirent tous en sécurité.
Une fois dans les vestiaires, les joueurs et les entraîneurs des Pacers restèrent debout, incrédules, en se demandant quoi faire. L’ambiance était surchauffée et les joueurs très en colère. Rick Carlisle, l’entraîneur, tenta de calmer les esprits, mais il fut pris à partie par O’Neal, qui l’accusa d’être intervenu à mauvais escient. Une nouvelle bagarre entre les joueurs et l’encadrement faillit s’ensuivre. Ce fut en voyant l’état de Mike Brown, les vêtements trempés et déchirés et la bouche pleine de sang, que les deux camps prirent conscience qu’ils étaient dans le même bateau et finirent par se calmer. Le match fut officiellement annulé avec 45,9 secondes à jouer. Score final : Indiana 97, Detroit 82.
Mais la soirée n’était pas encore terminée pour les Pacers. Ils devaient encore sortir de l’arène sans qu’aucun membre de l’équipe ne soit arrêté. Les policiers voulaient appréhender Artest, Mike Brown (accusé d’avoir agressé un spectateur par derrière) et un autre joueur. Mais le deuxième entraîneur assistant des Pacers, Kevin O’Neill, a rapidement envoyé tout le monde dans le bus qui les avait amenés jusqu’à l’arène. Les policiers ont voulu faire descendre les joueurs, qui ont refusé, et après avoir longuement discuté, O’Neill a obtenu des services de police qu’ils n’arrêtent personne, et interrogent les joueurs ultérieurement après examen de la vidéo.
*****

En fin de compte, la bagarre s’est bien terminée ; de manière incroyable, personne n’a été gravement blessé. Mais il était évident que des sanctions seraient prises. La ligue a agi dès le lendemain. David Stern a publié une déclaration qui commençait ainsi :
« Les événements du match d’hier soir étaient choquants, répugnants et inexcusables. Ils ont couvert de honte toutes les personnes associées à la NBA. Ceci démontre pourquoi nos joueurs ne doivent pas monter dans les tribunes, quels que soient les provocations ou le comportement des personnes assistant aux matchs. Une enquête est en cours et je m’attends à ce qu’elle soit terminée d’ici demain soir. »
*****
Épilogue

Ron Artest a été suspendu sans salaire pour le reste de la saison 2004-2005. Il a raté 86 matchs (73 de saison régulière et 13 de play-offs) et a purgé la suspension non-relative à la drogue la plus longue de l’histoire de la NBA. Il a également dû payer près de 5 millions de dollars d’amende. La saison suivante, Artest n’a joué que 16 matchs pour Indiana ; il a été placé sur la liste des joueurs inactifs, puis, le 25 janvier 2006, a été échangé à Sacramento contre Peja Stojakovic.
Stephen Jackson a été suspendu pour 30 matchs (sans salaire).
Jermaine O’Neal a été suspendu pour 25 matchs (sans salaire), avant de voir sa sanction réduite à 15 matchs.
Anthony Johnson, le meneur remplaçant des Pacers, a été suspendu cinq matchs (sans salaire).
Reggie Miller a été suspendu un match.
Ben Wallace a été suspendu six matchs.
Chauncey Billups, Elden Campbell et Derrick Coleman ont été suspendus un match.
John Green (le spectateur qui avait jeté le gobelet sur Artest) a été condamné à 30 jours de prison et deux ans de mise à l’épreuve pour voies de fait et coups et blessures.
Charlie Haddad, le spectateur assommé par O’Neal, a déposé plainte contre Anthony Johnson, O’Neal et les Pacers. O’Neal a été condamné à payer 1 686,50 $ à Haddad, qui a reçu une peine de deux ans de probation pour être entré sur le terrain sans autorisation et déclenché une bagarre. Il a été condamné à 100 heures de travaux d’intérêt général et à suivre un programme de travail de dix week-ends consécutifs dans un comté.
David Wallace a été condamné à un an de mise à l’épreuve et à des travaux d’intérêt général.
Bryant Jackson, le spectateur qui avait jeté la chaise dans les gradins, a été retrouvé après la diffusion sur internet de la vidéo de l’incident par la police locale. Il a été accusé d’agression et de coups et blessures, et a été condamné à une peine de probation de deux ans et à une amende de 6 000 $.
O’Neal, Artest, Jackson, Johnson et le pivot remplaçant des Pacers David Harrison ont accusés de voies de fait et de coups et blessures. Les procureurs du comté d’Oakland les ont condamnés à 250 $ d’amende chacun et un an de travaux d’intérêt général avec sursis. Cinq supporters des Pistons (John Green, William Paulson, Bryant Jackson, John Ackerman et David Wallace) ont été bannis du Palace à vie.
Les Pistons ont à nouveau rencontré les Pacers au deuxième tour des play-offs de 2005. Ils l’ont emporté en six matchs et sont allés jusqu’en finale pour la deuxième année consécutive, perdant contre San Antonio après une série de sept matchs extrêmement serrée.
Juste avant la bagarre, les Pacers avaient plié le match face aux Pistons et s’étaient légitimement positionnés en tant que l’équipe à battre en 2005. En l’espace de cinq minutes, tout est parti en fumée. L’année suivante, ils ont perdu au premier tour contre New Jersey, puis ont raté les play-offs les quatre années suivantes. Reggie Miller a pris sa retraite ; O’Neal est devenu une star grincheuse et trop payée exploitant mal son talent ; Jackson et Jamaal Tinsley ont été arrêtés après une fusillade à l’extérieur d’un club de strip-tease ; et Shawne Williams a été arrêté pour possession de marijuana en 2007. Les Pacers ont échangé Jackson à Golden State en 2007 contre Mike Dunleavy et Troy Murphy, O’Neal a fait ses bagages pour Toronto en 2008 et Tinsley est parti en 2009 après avoir reçu l’interdiction de jouer suite à l’incident du strip-club. Les fans en sont arrivés à détester tellement l’équipe que les Pacers ont affiché le plus mauvais taux d’affluence de la ligue, avec 12 000 sièges occupés en moyenne par match contre 17 000 avant l’incident du Palace, et ils ont failli déménager après avoir perdu 30 millions de dollars en 2009. Avec Larry Bird en tant que président des opérations, ils ont fini par se reconstruire avec des joueurs comme Danny Granger, Paul George et Tyler Hansbrough. Mais cela a duré six ans, et l’équipe a souffert de façon spectaculaire.
La NBA, pour finir, a tiré les leçons de l’incident et instauré de grands changements, concernant notamment la politique de la ligue en matière d’alcool et les relations entre les joueurs et les supporters. Comme Stern l’a déclaré un an après la mêlée :
« Premièrement, les joueurs ne peuvent pas monter dans les tribunes. Ils doivent laisser faire la sécurité et ne pas se faire justice eux-mêmes. Deuxièmement, les supporters doivent être responsables car ils ne peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent juste en achetant un billet. Troisièmement, nous devons continuer à revoir et mettre à jour nos procédures sur la sécurité et le contrôle des foules. »