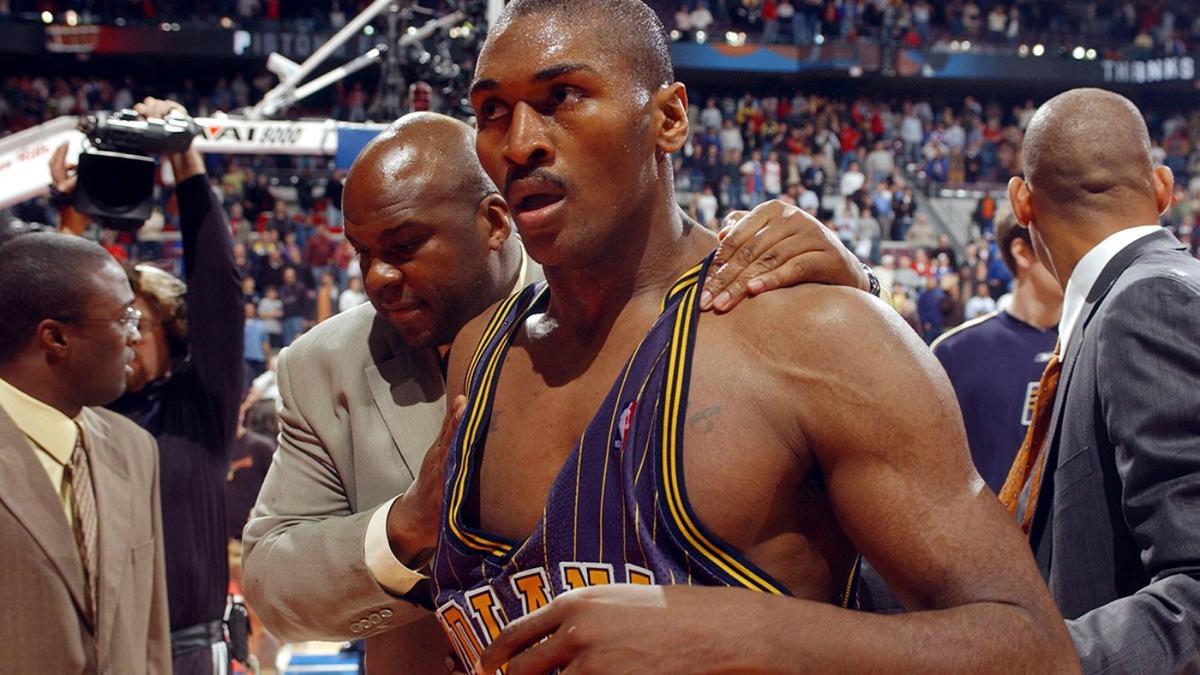« Grantland.com » était un site internet journalistique sur lequel étaient publiés des articles consacrés essentiellement au sport. Il a fermé définitivement ses portes le 30 octobre 2015. Quelques-uns de ses articles et portraits consacrés à la NBA (traduits en français) sont repris sur ce site. Les droits sur les textes, bien entendu, appartiennent à leurs auteurs.

Retour sur le début de carrière de Gregg Popovich, à l’époque où il entraînait la pitoyable équipe des Pomona-Pitzer Sagehens en troisième division universitaire.
par JORDAN RITTER CONN, le 1er octobre 2015
*****
Par un après-midi hivernal de 1980, l’homme qui allait devenir le meilleur entraîneur NBA de sa génération se tenait dans le gymnase décrépit d’une université de troisième division, désespéré et à court d’idées. Gregg Popovich avait trente ans et n’avait jamais rien gagné de sa vie. Il venait d’être embauché pour relancer le programme de basket-ball des universités de Pomona et Pitzer, deux facultés de sciences humaines et sociales du sud de la Californie si petites qu’elles avaient dû s’associer pour former une équipe sportive. Une équipe qui en cet instant regardait Popovich, vétéran de l’Air Force chargé d’amener l’excellence – ou, au mieux, la médiocrité – à l’une des pires équipes de basket-ball universitaires des États-Unis.
Les Sagehens étaient petits, lents, maladroits, peu combatifs, et n’avaient absolument aucun talent pour le basket-ball. C’étaient de futurs avocats, des intellectuels qui aimaient être entraînés de manière carrée. Popovich voulait gagner un titre national et n’avait aucune tolérance pour la dissidence. Pendant toute la saison, il avait eu du mal à trouver suffisamment de joueurs pour s’entraîner à 5 contre 5. Certains avaient quitté l’équipe. Beaucoup d’autres séchaient l’entraînement pour passer du temps au laboratoire de chimie, potasser leurs cours ou aller aux réunions du conseil étudiant. Ces jours-là, ils s’entraînaient à 4 contre 4.
À 4 contre 4, les Sagehens étaient un peu moins mauvais. L’espace supplémentaire sur le parquet ouvrait la défense et donnait davantage d’espace aux joueurs pour faire des passes et couper. Pour le match à suivre contre l’Université de Redlands, Popovich décida donc que, plutôt que d’essayer de rendre ses joueurs efficaces à 5 contre 5, il les ferait jouer avec un homme de moins.
Le jour du match, les Sagehens ont donc fait remonter la balle en laissant derrière eux un joueur au niveau de la moitié de terrain, occupant un défenseur. Et ils commençaient à exécuter une offensive à quatre joueurs, sans personne au poste. Des failles sont apparues dans la défense et des ouvertures se sont créées, permettant aux joueurs de prendre de bons tirs. Quand Redlands a compris la manœuvre et a voulu utiliser le cinquième défenseur pour faire des prises à deux, les Sagehens ont fait avancer leur cinquième joueur, maintenant sans surveillance, dans une zone libre de tout marquage. Il recevait une passe, tirait, et marquait parfois.
Plusieurs décennies avant de commencer à se passer de Tim Duncan pour la moitié de la saison et construire sa défense autour de l’incapacité de DeAndre Jordan à marquer des lancers francs, Popovich bousculait déjà les us et les coutumes du basket-ball, allant jusqu’à obliger les joueurs à tirer des lancers francs en sous-vêtements. « Il avait plusieurs cartes dans ses manches, explique Peter Osgood, un joueur de la première équipe de Popovich. C’était un magicien qui essayait de faire de nous des bons joueurs. »
Le système offensif improvisé a permis aux joueurs de marquer quelques paniers, mais Redlands a fini par s’ajuster. Pomona-Pitzer a poursuivi son horrible saison avec une nouvelle défaite. D’après ceux qui l’entraînaient et qui jouaient pour lui à l’époque, Popovich (qui a refusé d’être interviewé pour cet article) était à des années-lumière de la dynastie qu’il allait bâtir en NBA. Ce n’était qu’un jeune homme, sans rêve de grandeur, qui ne voulait pas être le dernier des derniers. Pour cela, il lui restait un long chemin à faire.

Les Sagehens sont aujourd’hui des hommes cultivés, avec des souvenirs plus ou moins clairs. Ils sont artistes, enseignants, avocats ou entrepreneurs ; tous sont liés par la période qu’ils ont passée avec celui qu’ils appelaient « Poppo ». Certains ont perdu contact avec leur coach. Beaucoup sont restés en relation avec lui. Plusieurs décennies plus tard, la plupart d’entre eux ont à son sujet la même opinion un peu controversée. Personne ne sait exactement comment le décrire.
« Hmmm… » (Rick Duque.)
« Eh bien… » (Tim Dignan.)
« Vous savez… » (Kurt Herbst, qui fait une pause, comme s’il voulait ne pas dire de bêtise.)
« C’était un bon entraîneur. »
Un bon entraîneur. Dans l’évangile de Popovich, cela se rapproche de l’hérésie. Les dieux sont-ils simplement bons à être divins ? Nous parlons d’un homme qui a remporté cinq championnats NBA au cours des seize dernières saisons, tous avec la même franchise ; d’un entraîneur qui a dominé avec des équipes à la fois laborieuses et improvisées, s’adaptant non seulement à ses joueurs mais aussi à la direction prise par la ligue. L’excellence de ses équipes, année après année, a remis en cause le délai conventionnel pendant laquelle les franchises de NBA peuvent rester prétendantes au titre. Avec le directeur général R.C. Buford, il a inspiré une maxime simple mais efficace d’entraînement et de gestion : « Si vous ne savez pas quoi faire, imitez les Spurs. »
Pourtant, les histoires racontées par les premiers joueurs qu’il a entraînés ne se fondent pas dans la tradition. Popovich n’était pas un génie qui officiait dans une petite école. C’était un entraîneur en pleine évolution, qui s’habillait comme l’as de pique et aimait le bon vin, mais n’avait pas assez d’argent pour acheter les meilleures bouteilles. Sur le terrain, il essayait des trucs bizarroïdes. Quand l’équipe se rassemblait, il tentait d’imiter Bobby Knight. Mais il se souciait profondément des gens autour de lui et même des tâches les plus banales de son travail. Et tout en bricolant, fulminant et expérimentant avec ses marginaux du basket-ball (ce qu’il fera pendant une décennie), il continuait à chercher les relations et les expériences qui l’aideraient à trouver son identité d’entraîneur.

À l’été 1979, l’université de Pomona avait une réputation bien ancrée : celle d’être l’une des écoles les plus sélectives du pays. Celle de Pitzer était plus jeune. Elle était née en plein mouvement hippie, et ses étudiants prétendaient en riant vouloir donner un côté « humain » aux sciences humaines.
Pomona et Pitzer faisaient partie du consortium d’établissements d’enseignement supérieur de Claremont, un groupe de cinq institutions voisines et étroitement liées qui se trouvent à environ une heure à l’est de Los Angeles. Pendant près de deux décennies, Pomona avait eu sa propre équipe. Après la création de Pitzer en 1963, les écoles se sont associées au début des années 70 pour former une équipe qui représenterait les deux établissements. Avant la fusion avec Pitzer, l’équipe de Pomona était mauvaise. Après la fusion, les deux équipes l’ont été ensemble.
Le doyen de Pomona, Bob Voelkel, un ancien joueur de troisième division au College of Wooster, a voulu changer les choses. Contrairement à la plupart de ses collègues, c’était un grand amateur de sport. « Dans ces petites écoles d’élite, explique Lee Wimberly, futur assistant de Popovich, scout des Spurs et entraîneur en chef de Swarthmore, presque tout le personnel de la faculté méprise les entraîneurs. Ils ne les considèrent pas comme leurs égaux. Bob Voelkel était différent. »
À l’été 1979, Reggie Minton, à l’époque entraîneur adjoint de l’Air Force, a reçu un appel lui demandant s’il voulait devenir entraîneur à Pomona-Pitzer. D’après le San Antonio Express-News, il a refusé mais a recommandé Popovich, un autre entraîneur adjoint de l’Air Force. Quelques semaines plus tard, Popovich et sa famille quittaient le Colorado pour la Californie du Sud, où il a hérité d’une équipe composée de joueurs admirablement médiocres. « Dans cette équipe, raconte Osgood, il y avait peut-être quatre ou cinq gars qui avaient été titulaires au lycée. Les autres n’étaient que des cireurs de banc. » L’équipe se construisait comme le faisait Pomona depuis des décennies : avec des tests de niveau. Les entraîneurs distribuaient des tracts, et les volontaires venaient au gymnase pour s’entraîner quelques jours. Les moins mauvais gagnaient le droit de devenir des joueurs de basket-ball universitaires.
Ils s’entraînaient, jouaient et perdaient, encore et encore. Lors de la première saison de Popovich, ils ont terminé avec deux victoires et vingt-deux défaites. Ils ont perdu contre Caltech, la pire équipe universitaire du pays, mettant fin à la série de 99 matchs sans victoire des Beavers. Mais si les malheurs de Pomona-Pitzer continuaient, ses joueurs se rendaient compte que quelque chose changeait. « Poppo était vraiment bouleversé quand nous perdions, confie Osgood. Avant, quand nous nous faisions écraser, on ne changeait rien du tout. Personne ne criait. Personne n’était puni ou pointé du doigt. Gagner ou perdre n’avait absolument aucune importance. Tout d’un coup, c’est devenu le cas. »
Et bientôt, les choses allaient prendre une ampleur encore plus grande. Depuis le jour où il avait mis les pieds sur le campus pour entraîner sa première équipe, Popovich avait commencé à penser au groupe de l’année suivante. Peu importe le nombre de systèmes offensifs improvisés et de techniques de motivation, les Sagehens ne gagneraient jamais sans des joueurs à peu près corrects. Alors, l’hiver suivant, il a essayé une chose qu’aucun entraîneur de Pomona n’avait jamais faite. Il a recruté.

Il a commencé par des lettres formelles, qu’il écrivait et envoyait à presque tous les lycées du tiers occidental des États-Unis. Dedans, il se présentait et expliquait ce qu’il voulait : des jeunes qui, premièrement, savaient jouer au basket-ball et, deuxièmement, avaient une chance d’intégrer l’une des deux écoles pour lesquelles il entraînait. « C’était le processus le moins efficace du monde », révèle Charles Katsiaficas, ancien assistant de Popovich et actuel entraîneur de Pomona-Pitzer. Après avoir bombardé la région avec leurs sollicitations, ils dressèrent une liste de plusieurs centaines de noms – des jeunes qu’un entraîneur d’une ville quelconque pensait être assez intelligents pour aller à Pomona ou Pitzer, et assez bons pour aider l’équipe de Popovich.
La plupart du temps, ces entraîneurs étaient à côté de la plaque. Ils recommandaient de très bons joueurs avec des moyennes insuffisantes, ou des étudiants brillants qui arrivaient à peine à faire un double-pas. Popovich prenait en compte toutes les recommandations. Il passait des coups de téléphone et posait des questions portant sur les qualités physiques et les résultats scolaires. De fil en aiguille, il réduisit sa liste, coupant non seulement les joueurs qui n’étaient pas assez bons, mais aussi ceux qui l’étaient trop – ceux qui se dirigeaient vers Stanford, la Californie ou plus à l’est, en Ivy League. Finalement, la liste ne compta plus qu’une dizaine de noms. Si les matchs de certains joueurs avaient été filmés, il les regardait. Si des joueurs vivaient à proximité, il allait les voir. Sinon, il n’avait pas d’autre choix que de se fier aux statistiques et aux avis de gens qu’il ne connaissait pas. Quand certains de ses choix sont arrivés sur le campus, Popovich ne les avait jamais vu jouer.
« Il était obsédé par ce processus », dit Katsiaficas. C’était un travail fastidieux. Il passait la nuit à son bureau, à lécher des enveloppes et donner des coups de fil. « Mais le plus important, c’était ce qui en découlait. Il fallait donc faire tout ça avec minutie. C’est une activité terriblement ennuyeuse, mais pour que les choses se passent correctement, il n’y avait pas d’autre choix. »
Et voici peut-être le secret le plus incroyable des annales de Pop. L’homme devenu célèbre pour être avare en paroles, l’entraîneur qui s’est fait une spécialité d’humilier les reporters nonchalants, adorait recruter. Il adorait vraiment ça, d’après ceux qui le connaissaient. Ses lettres étaient magnifiques, écrites à l’encre bleue et en cursive. Il s’intéressait aux motivations des joueurs en matière de basket-ball, et bifurquait vers leurs intérêts intellectuels, confiant dans le fait que seul Pomona-Pitzer pourrait récompenser les deux. Il appelait la nuit, souvent le dimanche, et demandait aux étudiants comment se passaient leurs cours et comment allaient leurs familles. Après avoir épuisé tous ces sujets, il essayait de les convaincre de rejoindre son équipe. Comme ils évoluaient en troisième division, il ne pouvait offrir aucune bourse, mais il faisait l’éloge du campus, de la faculté, du beau temps et la possibilité de jouer en championnat.
Et finalement, malgré le statut de génie grincheux le plus aimé du basket qu’est Popovich, il n’y a rien de plus normal. L’homme qui a écrit ces lettres et passé ces appels est l’homme qui a attiré LaMarcus Aldridge à San Antonio, celui que l’on imagine déguster du vin avec Boris Diaw, discuter de l’histoire des Aborigènes avec Patty Mills, et s’entraîner à rester impassible avec Kawhi Leonard et Duncan. Il aime parler, mais seulement en privé et selon ses termes. Dave DiCesaris, qui a choisi Pomona plutôt que d’intégrer une université moyenne de Division I, déclare à son propos : « Je ne sais pas si c’était réellement le cas, mais on sentait qu’il se souciait plus de vous en tant que personne que n’importe quel autre entraîneur. Il était vraiment curieux. On aurait qu’il voulait vraiment vous connaître mieux. »
Pour sa deuxième saison, Popovich a fait passer des tests à tous ses joueurs de l’année précédente. L’enjeu : retrouver leur place de titulaires. Tous ont été renvoyés, sauf deux. Ils ont été remplacés par un transfuge d’une autre école et par seize étudiants de première année. Sept d’entre eux sont entrés dans l’équipe universitaire, tandis que le reste constituait la nouvelle équipe réserve. La taille moyenne de l’équipe est passée de 1,88 m à 1,96 m. « Cette année représente un grand pas en avant dans notre programme », déclarera Popovich au journal étudiant de Pomona. Les Sagehens sont passés de deux victoires à dix, et l’année suivante, lors de la saison 1981-82, ils ont atteint les 50 % de victoires dans leur ligue.
Ils jouaient pour un homme qui était à tour de rôle désagréable et doux, enclin à des crises de colère et toujours à la recherche de son propre style. « Il voulait être Bobby Knight, raconte l’ancien joueur Dan Dargan. À l’époque, tout le monde voulait être Bobby Knight. » Un jour, à la mi-temps, Popovich a frappé un tableau noir à roulettes et l’a brisé en deux avec son poing. Il commençait chaque saison avec trois ou quatre meneurs de jeu, car il savait qu’un ou deux arrêteraient en cours de route. « Je le regardais crier après Tony Parker, dit Ashanti Payne, qui a joué meneur de jeu pour Pomona-Pitzer vers la fin du mandat de Popovich, et je n’avais aucun mal à me mettre à sa place. »
Il recrutait des joueurs corrects, mais rarement des joueurs capables de marquer des lancers francs de manière régulière. Alors, un après-midi, fatigué de leurs errances sur la ligne de pénalité, il a masqué les fenêtres du gymnase avec du papier brun opaque. Il a demandé à la responsable féminine de l’équipe de quitter la salle. Il ne voulait pas d’étrangers, pas de témoins. Les joueurs se sont rassemblés autour de lui et Popovich a annoncé ce qu’il avait prévu. Un par un, ils se présenteraient la ligne et feraient un lancer. S’ils réussissaient leur tir, ils s’éloignaient et attendraient leur prochain tour. S’ils le rataient, ils retireraient un vêtement. Rapidement, les chaussures, les chaussettes, puis les maillots sont tombés. Certains joueurs n’avaient plus sur eux que leurs sous-vêtements. Il avait essayé de les faire recommencer, il les avait punis avec des sprints, il avait voulu corriger leur mécanique de tir. Peut-être que leur faire honte allait enfin fonctionner. Ça n’a pas été le cas. Ça n’a jamais marché. Pendant presque toute sa carrière à Pomona-Pitzer, Popovich n’a jamais aligné une équipe douée aux lancers francs.

Beaucoup de joueurs partaient. C’était logique. Bien avant que les entraîneurs de football américain de la SEC ne popularisent le recrutement massif, Popovich engageait plus d’étudiants de première année par saison qu’il en avait besoin. Une fois sur place, certains ont décidé qu’ils ne voulaient pas subir son joug s’ils ne devaient jouer qu’en équipe réserve. Des étudiants de deuxième et troisième année ont abandonné le campus pour étudier à l’étranger, en Espagne ou en Grèce. Parmi ceux qui sont restés, certains ont choisi de se concentrer sur la préparation de leurs examens d’entrée plutôt que de jouer au basket-ball. « Vous n’êtes pas boursier et vous savez déjà que vous n’allez pas devenir professionnel, explique Chuck Kallgren, qui a joué au cours de la première moitié du mandat de Pop. En plus de cela, vous essayez de vous amuser, de profiter de la vie étudiante, et vous essayez de suivre le rythme dans une école vraiment difficile. Certains de nos gars se sont demandés pourquoi ils s’infligeaient ça. Ils rentraient dans leur dortoir après un match et leurs colocataires leur demandaient où ils étaient passés. La plupart de leurs amis savaient à peine que Pomona a une équipe. »
D’après les joueurs, Popovich comprenait la situation. Il les excusait lorsqu’ils devaient étudier, écrire des articles, assister à des réunions ou à des entretiens. Lorsqu’ils partaient pour un semestre à l’étranger, il les accueillait à leur retour, les intégrant parfois directement dans la rotation en milieu de saison. Popovich assistait à des cours, présidait des réunions et parlait de politique et de philosophie avec des professeurs autour d’une bouteille de vin, souvent prise dans le casier de huit bouteilles qu’il gardait dans le dortoir qu’il partageait avec sa femme et ses enfants. Steven Koblik, un professeur d’histoire de Pomona qui jouait le rôle de conseiller académique de l’équipe, le décrit comme un sparring partner intellectuel. « S’il y a une chose qu’il a retenu de toute cette expérience, c’est peut-être de voir les basketteurs comme davantage que des athlètes, déclare Mike Blitz, un ancien joueur de Saratoga, en Californie. Il nous considérait comme des personnes qui avaient quelque chose à dire. » Maintenant que Popovich n’est plus un entraîneur de troisième division mais une légende en devenir, des questions se posent : y avait-il des signes ? Comment a-t-il réussi à devenir celui qu’il il est aujourd’hui ? Ces réponses ne dépendent pas de faits mais de contorsions mentales, de tentatives d’attribuer un sens à des souvenirs qui autrement n’en auraient pas. « Entraîner Pomona ne lui a pas fait voir en nous des êtres humains, confie DiCesaris. Il avait déjà cette curiosité pour les gens. C’est justement pour cela que Pomona était parfaite pour lui. »
Popovich invitait les joueurs chez lui pour un plat qu’il appelait des « tacos serbes ». Il écrivait des lettres aux mères pour les féliciter des notes de leurs fils, et il faisait jouer les chauffeurs de banc quand il savait que leurs parents étaient dans la salle. Lorsqu’une étudiante de son staff s’est présentée à la présidence des troisième année, il a collé ses affiches autour du gymnase et a enlevé celles de son adversaire. (Elle a gagné.) Il a commencé en portant un costume et une cravate à chaque match, mais au fil des mois, il a laissé tomber le manteau, puis la cravate, et en mars, il piétinait la ligne de touche dans un sweat-shirt à capuche gris et un pantalon de survêtement. « Il a réalisé que nous étions ceux que nous étions, dit l’ancien meneur Evan Lee. Il s’est mis à notre niveau. On avait du mal, mais on a lutté ensemble. »

En 1984, Popovich avait amené le programme à un bon niveau de médiocrité. Les Sagehens étaient laborieux mais efficaces, avec une identité en constante évolution. « Certains entraîneurs recrutent des joueurs en fonction de leur système, explique Wimberly. Nous, nous prenions les joueurs que nous avions la chance d’avoir – ceux qui se présentaient au premier entraînement – puis nous ajustions notre système en fonction de leurs capacités. » Si l’attaque basée sur le rythme et l’espace des Spurs existait dans un coin de l’esprit de Popovich, on n’aurait pas été en mesure de le deviner en regardant jouer Pomona-Pitzer. Ils essayaient de bouger, de se faire des passes, d’appliquer les bases du basket-ball en équipe, mais le plus souvent, leur succès au milieu des années 80 venait de l’un des meilleurs joueurs de la ligue : Dave DiCesaris.
L’équipe a quand même failli perdre sa star en novembre 1984, après deux défaites des Sagehens à l’extérieur, à San Diego, aux alentours de Thanksgiving. Popovich, mécontent de la performance de ses joueurs, a embarqué ses joueurs dans la camionnette Econoline de l’équipe, est passé sans s’arrêter devant le restaurant où il avait réservé un brunch copieux, et les a conduits jusqu’à la salle de sport du campus. Il a fait venir les joueurs sur le terrain et les a fait courir. DiCesaris était furieux, pas contre son entraîneur mais contre son équipe. Il n’avait jamais perdu autant de matchs de sa vie. Il s’est mis à courir, furieux, en hurlant après ses coéquipiers. Puis il a ramassé un ballon de basket et l’a jeté à travers le gymnase.
DiCesaris se souvient alors d’avoir vu Popovich le fixer, ses yeux lançant des éclairs. Il a dit calmement : « Sors de mon gymnase. Tu ne fais plus partie de l’équipe. » DiCesaris est parti et a erré sur le campus sans savoir quoi faire. Il croyait être entré à Pomona uniquement parce qu’il pouvait dunker facilement et marquer des tirs de n’importe quel endroit du terrain. Il s’était déjà demandé s’il était digne de cette école. Maintenant qu’il avait perdu le basket-ball, il commençait à se demander si cela valait encore le coup de rester.
Dan Dargan, l’un des capitaines d’équipe, s’est approché de Popovich après l’entraînement. Il savait qu’il n’y avait qu’un seul joueur ayant le niveau de Première Division dans leur école, et Popovich venait de le chasser du gymnase. Dargan a dit à son entraîneur : « Nous avons besoin de Dave dans cette équipe. » Popovich a cédé. Il a invité DiCesaris à venir le voir dans son dortoir et l’a réintégré. « Ce moment, dit DiCesaris, aurait pu changer toute ma vie. » La saison suivante, les Sagehens ont remporté le championnat de leur Conférence, leur premier en soixante-huit ans. DiCesaris a été nommé MVP de l’équipe. Ils n’ont su qu’ils avaient remporté le titre que le lendemain de leur dernier match. Ils se sont entassés dans le bureau de Popovich, vérifiant le classement final. « Il a commencé à célébrer un peu, se souvient Lee. C’est là que j’ai compris qu’il n’y avait pas de mal à se réjouir. »
L’année suivant le titre de la conférence, Popovich a pris un congé sabbatique. Il s’était rapproché de Larry Brown après avoir essayé, sans succès, d’intégrer le staff de deux équipes entraînées par Brown – l’équipe olympique masculine américaine de 1972 et les Denver Nuggets (qui faisaient partie de l’ABA) en 1976. Pendant son congé, Popovich a passé la moitié de l’année avec Brown au Kansas, restant dans son ombre et servant d’assistant bénévole avec les Jayhawks. La saison suivante, Brown a invité Popovich à revenir à Lawrence avec l’équipe de Pomona-Pitzer pour un match amical de début de saison.
C’est ainsi qu’en 1987, les Sagehens se sont retrouvés à Allen Fieldhouse, où ils ont trouvé 16 000 fans hurlants, un futur entraîneur du Hall of Fame sur la ligne de touche adverse et Danny Manning, l’un des plus grands joueurs universitaires de tous les temps, s’échauffant à l’autre extrémité de la salle. Avant le match, Popovich a déclaré à son équipe : « Ne faites pas attention à ce que je vais dire aux médias. Je dirai certaines choses parce que j’y suis obligé, mais n’y faites pas attention. » Et bien entendu, il a joué l’humilité. « Nous ne pouvons pas gagner, a-t-il déclaré aux journalistes avant le match. C’est impossible. » Mais avec l’équipe, il a changé de ton. « Il voulait qu’on profite de l’occasion et qu’on fasse de notre mieux, dit Duque. Mais dès l’entre-deux de départ, l’esprit de compétition a surgi. Il n’était plus question de simplement s’amuser et de ne pas blesser Danny Manning. On était conscients de notre valeur, mais le but était d’essayer de gagner. »
Ils n’ont jamais eu la moindre chance. « Les pom-pom girls adverses étaient plus grandes que nous, explique Duque. C’était tout simplement impossible. » En seconde période, Popovich a demandé un temps mort, a sorti son tableau blanc et a dessiné une tactique en backdoor qu’il savait que Kansas aimait exécuter. Il a regardé l’un de ses joueurs, John Peterson. « Tu ne peux pas te prendre un écran, dit Lee en citant Popovich. Tu dois le contourner. Et si tu y arrives, tu dois sauter sur ton adversaire direct. Tu dois le gêner. » Lors de la possession suivante, bien entendu, Kansas a exécuté l’action exactement comme Popovich l’avait décrite. Peterson a pris un écran. Il n’a pas réussi à le contourner. Il n’a jamais pu sauter sur son adversaire direct. Il n’a pu que lever les yeux pour voir son adversaire dunker.
Sur le banc, les Sagehens ont éclaté de rire. Il n’y avait rien que Popovich puisse faire, rien que personne ne puisse faire, à part se tenir sur la touche et sourire en secouant la tête. Pomona-Pitzer a perdu 94-38. Dans le journal étudiant de la semaine suivante, le résumé du match avait pour titre : « Kansas surprend les Sagehens ».

Au cours des décennies suivantes, tout en passant du banc des Spurs et du poste d’assistant de Brown à celui de directeur général de San Antonio (et de revenir sur le banc en tant qu’entraîneur principal), Popovich a gardé le contact avec ses anciens joueurs de Division III et ses entraîneurs adjoints. Il venait voir leurs matchs et leurs entraînements chaque fois que les Spurs étaient à Los Angeles. Après les matchs, il parcourait le pays en voiture jusqu’à Salt Lake City, Oakland, Seattle ou Minneapolis, et en sortant des vestiaires, il trouvait ses anciens joueurs, ses assistants et même ses anciens managers prêts à aller dîner avec lui. Certains joueurs confient qu’il les a invités à San Antonio en insistant pour qu’ils ne paient rien. Il a visité des hôpitaux. Il posait des questions sur les carrières, la santé et les familles. De temps en temps, ils écrivaient pour demander des conseils, et il leur répondait.
Aujourd’hui, les joueurs sont un peu sur la défensive. Ils le voient à la télévision, en train de dévorer des reporters en entier. Ils savent qu’il peut être particulièrement retors. Mais ils insistent sur le fait que si l’on arrive à découvrir sa tendresse, on voit les moments négatifs de Popovich comme une part de son charme. « J’avais du mal à juger sa valeur en tant qu’entraîneur à l’époque, dit DiCesaris. Mais je savais que je jouais pour quelqu’un qui se souciait de moi. Et les années qui ont suivi m’ont donné raison. »
Aucun des joueurs de la Division III de Popovich ne s’attendait à ce qu’il fasse une carrière d’entraîneur digne du Hall of Fame. Pas plus que Popovich, selon son ancien entraîneur adjoint Katsiaficas. À Pomona, le futur gourou des Spurs ne suivait pas la NBA et il n’avait pas l’ambition nécessaire. Katsiaficas déclare : « Il ne se souciait pas de sa carrière, mais il se souciait vraiment, vraiment de son travail. » Pourtant, parfois, dans les moments calmes avec ses assistants, Popovich s’interrogeait sur ses propres capacités. Wimberly se souvient de l’avoir entendu dire : « Vous savez, on a tout ce qu’il faut pour être aussi bons que les entraîneurs qu’on voit à la télévision. La seule différence est qu’ils ont eu les bonnes opportunités ou qu’ils connaissent les bonnes personnes. »
Au cours de son semestre au Kansas, Popovich a lié connaissance avec la bonne personne. Lui et Brown s’étaient déjà bien entendus, mais le fait de travailler ensemble cette saison a approfondi leur lien. Et quand Popovich est revenu à Pomona pour la saison 1987-88, tout s’est accéléré. Le doyen qui l’avait embauché – Bob Voelkel, que Popovich appelait son deuxième père – est décédé peu de temps après le retour de Popovich d’un congé sabbatique. L’administration était moins désireuse de soutenir les activités sportives. Et à l’été 1988, lui, sa femme et son entraîneur adjoint Wimberly se sont réunis pour se demander s’il était temps de faire un changement. Ils ont allumé la télévision et ont vu que Larry Brown avait été embauché par les Spurs. Le mentor de Popovich se dirigeait vers la NBA. « Tu devrais l’appeler, se souvient d’avoir dit Wimberly à Popovich. Il peut peut-être te prendre avec lui. »
Mais Pop était réticent. D’une part, il hésitait encore à quitter ses joueurs et l’école où il avait élu domicile. Mais il y avait quelque chose en plus : il ne savait pas s’il le méritait. « Il pensait que Larry Brown allait lui rire au nez », dit Wimberly. Popovich avait trente-neuf ans et était devenu un gagnant. Pourtant, il semblait toujours manquer de la confiance qui le mènerait au sommet. Wimberly l’a encouragé. La femme de Popovich aussi. Finalement, il a cédé. Et tout a commencé ainsi, il y a vingt-sept ans, juste avant de recevoir l’offre qui le mettrait sur la voie de cinq championnats NBA – lorsqu’un Gregg Popovich hésitant a pris son téléphone.